
|
Les années d’Éphèse furent un incessant combat contre la « crise judaïsante ».
Rappelons que l’on a coutume d’opérer une distinction entre les judéo-chrétiens,
qui
sont des chrétiens d’origine juive qui n’ont pas abandonné les prescriptions de
la loi
mosaïque et les judaïsants, les Juifs qui non seulement appliquent la Loi mais entendent
l’imposer en outre aux païens. Deux étapes épistolaires marquent le combat :
l’Épître
aux Galates et l’Épître aux Philippiens. |
|
|
|
|
Paul visite les Galates lors de son second voyage missionnaire. Après une
longue
marche qui commence en pente douce, parmi les pêchers de la Cilicie, et qui se
poursuit au milieu des tempêtes, des cols à franchir, de la neige, tout cela pour arriver à
des petites cahutes malpropres où l’on tremble de fatigue et de faim, où la fièvre
vous
fait grelotter sous les maigres couvertures – après cette randonnée il arrive au pays
des
Galates. Il le dit lui-même, il n’avait pas l’intention de s’y arrêter mais
une maladie
providentielle le contraint à prolonger la halte. Paradoxalement, ces frontières de la
« Barbarie » lui fourniront plus d’aide et de réconfort que tous les « civilisés »
qu’il a
connu :
« Vous
le savez, j’étais malade dans ma chair quand je vous ai évangélisé la première
fois,
et, malgré l’épreuve à laquelle ma chair vous mettait, vous n’avez eu ni dédain
ni dégoût. Au
contraire, vous m’avez accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus ! Où
donc
est votre bonheur d’alors ? Car je vous en rends témoignage : s’il eût été possible de vous
arracher les yeux pour me les donner, vous l’auriez fait ! » (Ga 4, 14-15.)
Les Galates sont des Celtes, à l’instar de nos ancêtres les Gaulois,
venus en Asie
mineure en 278 av. J.-C. avec armes, femmes, bagages, tentes, dieux, en longues
caravanes précédées de fourriers et d’éclaireurs belliqueux. Après une
longue marche,
ils se sont concentrés autour d’Ancyre, l’actuelle Ankara, puis de Pessinonte.
Posidonius, dans son ouvrage Les Deipnosophistes les décrit comme de rudes
guerriers aux coutumes très proches de celles des Gaulois et César les dit curieux et
vifs d’esprit. Ils parlent sans doute gaulois et grec, ce qui facilita l’entreprise de Paul.
Ils
entretiennent avec le premier peuple du pays, les Phrygiens, des relations plus ou
moins bonnes, beaucoup moins hostiles que l’invasion qui leur fit occuper le territoire
d’autrui ne pourrait le laisser présager. Les Phrygiens étaient en effet un peuple plutôt
pacifique, voire indolent, qui assimila très tôt ces nouveaux voisins. Les Galates, peu à
peu, adoptèrent la religion phrygienne et accédèrent à de hautes fonctions sacerdotales
et politiques. Leur déesse était devenue Cybèle, qu’ils adoraient au milieu de transes,
de
sacrifices et de banquets.
L’évangélisation que mène Paul en Galatie est un succès,
d’autant plus étonnant qu’il
ne peut s’appuyer sur aucune communauté juive, ni sur une culture propice à la
propagation de la foi. Lorsqu’il part, il laisse une Église bien constituée et assez
solide. |
|
Peu après son départ arrivent d’autres missionnaires, des intrus. À en juger d’après
l’Épître aux Galates, ils appartiennent à des milieux juifs : ils arrivent
tout droit
d’Antioche, après que la « ligne judaïsante » l’a emporté
dans la communauté, et ils se
sont lancés dans une contre- offensive de fidélité à la Loi, suivant à la trace
Paul pour
« rectifier » sa prédication. Ce ne sont pas des ennemis personnels de l’apôtre,
simplement d’honnêtes missionnaires, convaincus de la nécessité de la Loi.
Malheureusement, nous n’avons pas gardétrace de leur prédication.
Sans doute le
premier coup de semonce fut-il dirigé contre Paul. L’argument était facile : il
n’a jamais
connu Jésus. Aussi bâtirent-ils leur démonstration autour de son passé et tournèrent-ils
leur discours d’une manière qui devait ressembler à un discours àcharge :
« Paul ?
Il n’a jamais fait partie du groupe que le Seigneur a rassemblé quand il vivait
encore parmi nous. Encore moins fait-il partie des Douze, qui sont les vrais apôtres, les
“officiels”. Au contraire, il était de ceux qui persécutaient nos premiers frères :
il les dénonçait
pendant les assemblées juives. Vous vous rendez compte que c’est auprès d’un persécuteur
de chrétiens que vous avez appris le message qui sauve ?
«
Quant à sa légitimité missionnaire, ne nous en parlez pas. Est-il recommandé par
Jérusalem ? Pas du tout. Bien sûr, il a fait partie du groupe d’Antioche, mais
vous voyez bien
qu’il a été récusé puisque nous, nous sommes les véritables missionnaires
mandatés, nous,
qui sommes venus vous prévenir contre lui.
«
Vous nous dites “qu’est-ce qui distingue ce qu’il nous disait de ce que vous nous
apprenez ?” Vous avez raison, ce qu’il vous a enseigné est cohérent et même,
par certains
aspects, il est d’accord avec nous. Mais sur tous les points concernant le respect de la Loi,
vous voyez bien qu’il a manigancé ses petites affaires à partir des bribes qu’on
lui a apprises
dès qu’il s’est converti. »
L’attaque est triple : elle porte sur la personne de Paul, l’ancien
persécuteur, sur sa
légitimité missionnaire et sur le contenu de sa prédication, c’est-à-dire
sur ce qu’il
annonce du Christ. Probablement, les missionnaires venus d’Antioche devaient
enchaîner sur ce thème, en réhabilitant le respect dû à la Loi :
« Tout
a commencé avec Abraham. Comme on vous l’a dit, c’est le premier homme àqui
Dieu ait parlé, le premier avec qui il ait passé alliance. Être sauvé, c’est
participer à cette
alliance et la seule façon d’y participer, c’est de devenir fils d’Abraham car
Dieu a dit lui-
même : “J’affermirai mon alliance avec toi, et après toi avec ta race dans
la suite des
générations, une alliance éternelle : je serai ton Dieu et le Dieu de ta race après
toi.”(Gn 18, 7).
« Cessez
donc de répéter “Nous ne sommes pas Juifs comme vous, jamais nous ne
pourrons faire partie de ce peuple dont vous êtes”. Certes, vous n’êtes pas Juifs,
mais vous
aussi vous êtes fils d’Abraham ! Ne dit-on pas dans l’Écriture qu’Abraham
eut un premier fils,
autre qu’Isaac, Ismaël, qu’il eut avec sa servante Aggar ? Lui aussi est père
d’un grand peuple
(Genèse xxi) ! et lui aussi, Dieu l’a regardé avec faveur, quoiqu’il fût
parti dans un pays
étranger !
«
Alors, nous vous en supplions, réintégrez la famille d’Abraham ! Rien n’est
plus simple. Il
ne s’agit pas d’abandonner votre foi en Jésus Christ, qui accomplit les promesses des
Livres
Saints, mais de vous faire circonscrire et de vous mettre à respecter la Loi. »
Cette prédication était plutôt convaincante : la vivacité
de la réponse de Paul en
témoigne, les Galates ont cédé à la propagande. Étaient-ils mal évangélisés ?
Dans ce
cas, ils seraient plutôt revenus à leurs anciens rites. Ils cèdent parce que Paul ne
leur a
pas donné de consignes assez précises. De manière générale, les lettres de
l’apôtre
contiennent de nombreuses parties morales mais très peu de détails pratiques : ce
silence est caractéristique de la manière paulinienne. Paul accorde beaucoup plus
d’importance à la liberté de ses communautés qu’à sa mainmise personnelle
sur elles.
S’il met en place des responsables et des dirigeants, il ne cherche pas à installer une
hiérarchie. Certes, cette conception permet au mieux l’épanouissement de la vie d’une
communauté, mais elle a l’inconvénient de laisser croire aux communautés qu’elles
sont livrées à elles-mêmes. Paralysés par l’incertitude, les Galates furent
sans doute
soulagés de trouver une Loi qui puisse les sauver de l’indécision.
Les judaïsants ne remettaient pas en cause l’ensemble de l’enseignement
de Paul,
mais le point précis de la circoncision et du respect de la Loi. Ils devaient s’appuyer sur
Abraham puisque c’est sur Abraham que Paul leur répond. |
|
Paul réagit vigoureusement à la crise en Galatie car il perçoit
que ce qui se joue dans
cette petite province n’est plus seulement une crise d’incompréhension, mais une
véritable attaque sur sa propre crédibilité et sa conception de l’évangélisation.
Pour
parer l’attaque, il se bat pied à pied, argument contre argument. Aussi procède-t-il
en
trois temps : il commence par restaurer sa propre crédibilité (Ga 1–2) puis il cherche à
convaincre de l’inutilité de la Loi (Ga 3–4) pour enfin tracer les grandes lignes d’une
réconciliation avec la vie chrétienne telle qu’il la conçoit (Ga 5–6).
Pour répondre à l’opération de dénigrement dont il est
victime, Paul choisit une
stratégie inattendue : accepter les arguments de ses adversaires pour les tourner à son
avantage. La technique rhétorique est connue : les Anciens l’appelaient antiparastase.
Certes, dit-il, je n’ai rien eu à faire avec l’Église de Jérusalem : tout
le monde connaît
mon passé de persécuteur. Au contraire, n’est-ce pas une preuve de ma crédibilité ;
quel intérêt puis-je avoir à vous prêcher l’Évangile ?
« Est-ce
la faveur des hommes ou celle de Dieu que je veux gagner aujourd’hui ? Est-ce à
des hommes que je cherche à plaire ? Si j’en étais encore à vouloir plaire à des hommes, je
ne serais plus le serviteur du Christ. » (Ga 1, 10.)
Ce qui était un inconvénient se tourne en avantage : alors que
les missionnaires
durent apprendre leur Évangile d’autres hommes, ceux de Jérusalem, lui a pu
l’apprendre sans médiation, à la source. Non pas d’un homme, mais de Dieu lui-même,
le Seigneur Jésus Christ :
« Je
vous le déclare donc, mes frères, l’Évangile que je vous ai annoncé n’est
pas celui
d’un homme car ce n’est pas d’un homme que je l’ai reçu ni appris, mais de
la révélation de
Jésus le Christ. » (Gal. 1, 11-12.)
Sa légitimité d’apôtre n’est plus difficile à établir :
puisque Jésus lui est apparu, c’est
la preuve que sa mission est divine, elle provient tout droit de sa révélation. Il suffit
donc
de refaire l’historique de la lutte avec les judéo-chrétiens (Ga 2, 1-21), retourner à
Jérusalem pour y revivre le conflit, souffrir de nouveau à Antioche le revirement de
Pierre : les Galates doivent bien reconnaître que ce n’est pas lui qui est en tort !
Sa crédibilité restaurée, Paul peut s’attaquer au contenu
du message de ses
adversaires. Deux solutions s’offrent à lui : ou bien tenter une conciliation avec les
judaïsants ou bien consommer la rupture et préciser ses idées sur la Loi.
L’heure n’est plus à ergoter sur la circoncision ou certaines
prescriptions : Paul
assaille directement la Loi. Ses arguments sont de trois natures : argument
d’expérience, argument issu de l’Écriture sainte, argument théologique.
L’appel à l’expérience, tout d’abord, est une évocation
de la conversion des Galates.
Au cours de la prédication de Paul, beaucoup connurent des expériences mystiques :
ces preuves sensibles ne prouvent-elles pas l’effectivité de la prédication ? Et
pourtant,
cette réussite se fit sans la Loi, puisque les Galates ne savaient rien du judaïsme. La
Loi, conclut-il, n’est pas utile, seule compte la foi :
« Crétins
de Galates, qui vous a ensorcelé, vous qui avez eu sous les yeux l’image de
Jésus Christ crucifié ? Je n’ai qu’une chose à vous demander : est-ce
pour avoir pratiqué la
Loi que vous avez reçu l’Esprit, ou pour avoir cru à la prédication ? […]
Celui qui vous donne
l’Esprit et opère des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la Loi ou parce
que vous croyez à la prédication ? » (Ga 3, 1-2 & 5)
Étrangement, cet argument, qui s’adresse directement aux Galates paraît
ne pas
être suffisant. Paul commence alors une exégèse digne des rabbins, plus attentive au
détail littéral du texte qu’à sa situation générale. Il emploie des arguments
tellement
subtils qu’ils passent sans doute la compréhension de ces rudes Gaulois. Au lieu
d’utiliser une langue simple et des arguments frappants, il chicane les expressions,
complexifie les explications, bref, il s’adresse, à travers l’auditoire de ces païens à peine
évangélisés, directement à ses adversaires.
Il part d’un constat simple : Abraham n’a pas eu besoin de la
Loi pour croire et être
sauvé car la Loi a été donnée à Israël bien après la mort du
patriarche.
« On
trouve dans l’Écriture : Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme de la
justice [Gn 15, 6]. Comprenez-le donc bien : ceux qui sont de la foi, ceux-là sont les fils
d’Abraham. » (Ga 3, 6-7.)
Le Seigneur Dieu promet au vieillard Abraham, marié à une femme stérile,
une
postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel. Malgré l’absurdité de
la parole,
Abraham s’y fie et engendre tout Israël : les Juifs descendent de cet acte de foi.
Pourtant, peut-on rétorquer à l’apôtre, cette Loi vient quand
même de Dieu :
comment expliquer qu’elle soit devenue un obstacle pour la propagation de l’Évangile ?
Répondant par anticipation à l’objection, l’apôtre poursuit :
« Avant
la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la Loi, dans l’attente de
la foi qui devait se révéler. Ainsi la Loi fut-elle notre pédagogue nous conduisant au
Christ,
pour que nous obtenions de la foi notre justification. Mais la foi venue, plus de pédagogue !
Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi au Christ Jésus. Vous tous en effet, baptisés
dans
le Christ, vous avez revêtu le Christ : il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave
ni homme libre,
il n’y a ni homme ni femme ; vous n’êtes qu’un dans le Christ Jésus. »
(Ga 4, 23-28.)
La Loi n’était qu’une étape, une contrainte nécessaire à la croissance de l’humanité.
Elle a ainsi joué le rôle du pédagogue, de l’esclave qui dans l’Antiquité
conduisait l’enfant
à l’école. La Loi maintenait l’humanité dans une certaine pureté de mœurs
et un certain
respect envers Dieu afin qu’elle puisse doucement accepter le message du Christ ; les
geôliers et les surveillants ont leur utilité pour former les hommes ! Mais après
la venue
du Christ, nul besoin de cette coercition. Et, ajoute l’apôtre, nul besoin de cette
séparation entre eux. La fin de l’intérim de la Loi marque le début de celui de
l’unité :
dans l’ère du Christ, le temps où l’on a revêtu le Christ comme un vêtement,
les
différences entre les hommes se volatilisent : ni Juif, ni Grec…
Paul consomme-t-il véritablement la rupture avec le judaïsme ?
Il convient de ne pas
durcir son propos. En effet, son intention n’est pas de condamner la Loi dans son
ensemble ou bien de proscrire le judaïsme. En affirmant la primauté de la foi, il ne fait
que répéter l’accord de Jérusalem : les Juifs peuvent conserver leurs prescriptions
mais il n’est pas question de les imposer aux païens. Il ne s’insurge pas véritablement
contre la Loi mais contre le prosélytisme.
Aussi affirme-t-il de façon centrale la foi au Christ. Alors que dans l’Épître
aux
Thessaloniciens, l’apôtre se préoccupait de questions de résurrection, de sainteté
et
abordait le problème de la croyance au Christ comme par ricochet, l’Épître aux Galates
marque sa volonté de penser le mystère de Jésus. Et pour mener cette tâche à
bien, il
utilise des notions simples issues de la vie quotidienne comme celle du rachat
(Rédemption) – Dieu nous a racheté comme des esclaves qui ont réussi à
payer leur
liberté – ou comme celle de l’adoption, ce procédé très courant dans l’Antiquité
qui
consistait à faire de quelqu’un plus que son propre fils : son héritier et son légataire.
Il peut ainsi approfondir les slogans de l’Église d’Antioche,
comme « vous avez été
appelés à la liberté » (Ga 5, 13) : la vraie liberté n’est pas
la possibilité de faire tout ce
qui plaît, mais elle est une véritable conquête qui demande de la vigilance, pour ne
pas
retomber dans l’esclavage de la Loi ou dans d’autres esclavages religieux, à l’instar
de
ces « éléments du monde » dont il parle, forces obscures des idolâtries
passées ou
simplement habitudes très repérables de la vie en société.
« Aussi
plus d’esclaves mais des fils ; des fils, et donc des héritiers grâce à Dieu.
Jadis,
lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui n’en sont pas par leur
nature ; mais maintenant que vous avez connu Dieu ou plutôt qu’il vous a connus, comment
retourneriez-vous à ces éléments sans force ni valeur, auxquels vous voulez de nouveau
vous
asservir ? » (Ga 4, 7-9)
Le Christ doit donner la ligne de conduite. Il faut, comme l’apôtre,
pouvoir dire « ce
n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). En imitant
le Christ, en
adoptant ses façons de réagir, les chrétiens perpétuent la vie du Christ en eux,
comme
le fait celui qui préserve les habitudes de langage, les sentences, les mimiques, les
idées, les habitudes, les enseignements, bref la vie d’un être cher qui est mort. À
travers leur enthousiasme, leur travail, leur conduite, le Christ s’enflamme, œuvre,
intervient.
Plus l’apôtre progresse dans sa lettre, plus le ton s’anime, plus
la tendresse qu’il
éprouve pour les Galates devient manifeste. L’Épître aux Galates conserve avec
précision le mouvement psychologique de l’épistolier ; à mesure qu’il
gagne du terrain
sur ses adversaires, qu’il sillonne par la pensée la route d’Éphèse vers la
Galatie, qu’il
poursuit sa rédaction, il s’avise qu’il ne peut en vouloir à ses enfants dans la
foi. Le chef
d’Église offensé dans sa légitimité se métamorphose lentement en père
de
communauté soucieux :
« Des
gens désireux de se faire bien voir des autres dans la chair : voilà ce que sont ceux
qui vous imposent la circoncision, à dans le seul but d’éviter la persécution pour
la croix du
Christ. Car ceux qui se font circoncire n’observent pas eux-mêmes la Loi ; ils veulent
que
vous soyez circoncis, pour se vanter dans votre chair. En ce qui me concerne, puissé-je ne
jamais me vanter sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ, qui crucifié le monde
pour moi et moi pour le monde. Car la circoncision n’est rien, ni la non-circoncision : il
s’agit
d’être une créature nouvelle ! Et à tous ceux qui suivront cette règle,
paix et miséricorde, ainsi
qu’à l’Israël de Dieu. Dorénavant que personne ne me fasse des ennuis :
je porte dans mon
corps les marques de Jésus. » (Ga 6, 12-17.)
D’un même mouvement, il peint sa sollicitude paternelle et « invente »
l’anthropologie
paulinienne. Pour la première fois, le fameux mot « chair », σάρξ,
fait son apparition.
Arrêtons- nous quelques instants. L’homme, pour Paul, n’est pas une âme légère
et
amie de Dieu inscrite dans un corps lourd et pesant. L’homme est plutôt un être
intermédiaire, en tension entre deux mondes : un monde temporel, éphémère et
en
mouvement, livré à la « corruption », c’est-à-dire à l’anéantissement,
et un monde
spirituel, éternel, qui est destiné à la « gloire », à la δόξα,
c’est- à-dire à la proximité
d’avec Dieu. La frontière entre le monde temporel et le monde spirituel ne recouvre que
très imparfaitement la frontière entre le monde des phénomènes et le monde vécu
selon
la foi, mais la difficulté est que Paul emploie la même terminologie quand il se réfère
au
monde des phénomènes et quand il s’intéresse au monde selon la foi.
1. Pour décrire l’homme dans ses manifestations empiriques, Paul utilise
plusieurs
mots, qui ne sont pas, comme dans la philosophie grecque, la désignation d’instances
psychologiques ou de réalités neuronales mais, plus exactement, des concepts
phénoménologiques, des descriptions de ce qui se manifeste quand on observe un
homme. Le concept fondamental est la chair (σάρξ) qui désigne l’homme
dans son
existence terrestre : la chair, c’est à la fois le corps et l’esprit, l’âme
et l’intelligence, c’est
l’homme entier, périssable et naturel, présent au monde et au visible. Or, comme
chacun peut le constater, l’homme a un mode d’existence extérieur et une « vie
intérieure ». L’extériorité est décrite par le mot corps, σῶμα,
qui recouvre toutes les
manifestations extérieures de la personnes : sa présence visible, ses cicatrices, sa
sexualité. La vie intérieure est plutôt le domaine de l’esprit, la πνεῦμα,
qui rentre en
opposition avec les manifestations sensibles du corps. Au sein de cet esprit, on peut
distinguer plusieurs activités différentes : la puissance de vie, qui s’appelle âme chez
Paul, ψυχή, la puissance de compréhension ou entendement, νοῦς,
et enfin l’ensemble
des sentiments, des désirs, des passions, que Paul nomme cœur, καρδία.
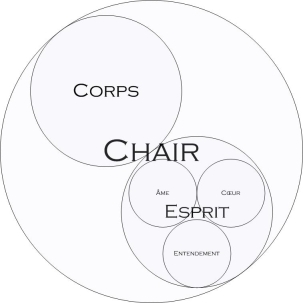 Figure 2: l'homme empirique chez Paul
2. Si Paul hérite ces concepts de l’anthropologie juive, il les transforme
en fonction de
sa propre expérience de foi et construit des tensions qui révèlent l’action conjointe
de
Dieu et du Péché en l’homme. Ainsi bâtit-il une antithèse entre la chair et
l’esprit. La vie
selon la chair caractérise l’existence pécheresse des chrétiens, qui n’est
pas une vie de
péché (car le péché est vaincu une fois pour toutes par le Christ) mais une sorte
de
résidu du péché, un succédané de péché, un retour en esclavage. Au
contraire la vie
selon l’Esprit désigne la vie telle que Dieu l’aime, la vie qui permettra à l’homme
de
comparaître devant lui. En ce sens, l’esprit se comprend comme une sorte de
continuum entre Dieu et les hommes : c’est par son esprit que l’homme peut avoir
accès à l’esprit de Dieu et à la vie de Dieu. On voit donc bien que, pour Paul,
le chrétien
n’est pas un composé de chair et d’esprit, ou pire, d’âme et de corps :
son existence est
en tension entre la chair et l’esprit et sa vie écartelée entre deux mondes.
Dès lors, au sein du monde chair/esprit, les réalités de chair,
d’âme et d’entendement
prennent une interprétation différente. Le corps, qui est pure expression de l’homme
sans nuance de péché, peut se soumettre au joug du péché, qui devient son maître.
Il
se vend au péché et cesse d’être lui-même. Le corps assujetti au péché
exprime alors
le moi aliéné. Le corps qui vit selon l’esprit, au contraire, peut être sauvé,
il devient alors
σῆμα τᾶς δοξᾶς, « corps de
gloire », corps ressuscité. À l’instar du corps, l’âme et
l’entendement peuvent se vendre au péché et se pervertir : l’homme « psychique »
est
celui qui a régressé vers un stade charnel et l’entendement altéré se métamorphose
en
raison charnelle, vaine, légère et cherchant par l’intelligence à servir le péché. |
|
Le concept de péché a connu un développement théologique
et moral tellement
complexe qu’il risque d’aveugler le lecteur moderne de Paul. Il est exclu de donner dans
les limites de cet ouvrage une définition exhaustive de ce terme. Tout au plus peut-on
tenter d’approcher l’intuition paulinienne, quitte à utiliser une métaphysique un
peu
maladroite.
Pour définir le péché, le plus simple est de remonter à sa
définition. En grec, le mot
ἁματρία dérive d’un verbe qui signifie « manquer
sa cible », « se tromper de chemin ».
Pour parler familièrement, le péché décrit un état de « loupé ».
En cela, il s’oppose à un
état où « ça marche » : celui où l’homme agit conformément à l’esprit de Dieu et peut,
ainsi, comparaître devant lui et vivre de la vie divine. Il s’agit bien d’un état
et non d’une
succession d’actes peccamineux que l’homme aurait pleine faculté d’arrêter à sa
volonté. Le péché selon Paul doit donc se comprendre plutôt comme un « mal
corporatif », le corollaire de sa vie terrestre et de sa liberté où tout peut à
tout moment
« louper ».
Le mal étant corporatif, l’homme ne saurait, de lui-même, y mettre
un terme. Aussi
faut-il une intervention divine, un don divin qui mette fin au péché : c’est le
propre de la
grâce, χάρις. Celle- ci a été donnée de manière suffisante
lors de la venue du Christ sur
terre : par sa mort et sa résurrection, il nous a racheté au péché de manière
définitive,
comme un homme rachète la liberté d’un membre de sa famille tombé aux mains des
pirates. Malheureusement, le mal n’a pas cessé car un succédané de péché
a trouvé le
moyen de s’insinuer en l’homme : c’est essentiellement pour le combattre au sein
de
ses Églises que Paul écrit ses épîtres.
Après ce long détour, on comprend que se « vanter dans la
chair » des Galates,
c’est se croire forts parce qu’un petit morceau de chair corruptible a été enlevé,
alors
que Paul, lui, parle à un autre niveau : celui du corps, qui ne saurait être atteint
par la
corruption. Le problème de la circoncision n’est donc pas une difficulté : il n’est
tout
simplement pas pertinent. Quelle souffrance, aussi, que ses enfants se séparent de lui
pour des bêtises et pour servir l’orgueil de missionnaires malintentionnés ! |
|
Pendant que Paul répondait aux Galates, sa situation à Éphèse
devenait de plus en
plus inconfortable. Encore une fois, l’apôtre faisait un peu trop parler de lui au goût
des
grandeurs d’établissement. Derechef, on lui fait grief probablement de prêcher une
religion nouvelle, de troubler l’ordre public voire de se mettre à dos les Juifs de la ville. À
Éphèse, la situation est un peu différente des autres villes où Paul connut la
persécution. La ville, on l’a dit, était un grand centre religieux dédié à
Artémis. Les
marchands de souvenir, maquettes de temples en métal, gourdes contenant de l’eau
miraculeuse, statues en argent de la déesse, ainsi que les prêtres, ne devaient pas voir
d’un œil très favorable cet empiétement sur leur terrain d’action. L’auteur
des Actes
retient ce motif d’hostilité pour expliquer les difficultés devant lesquelles Paul est
en
butte.
« Un
certain Démétrius, un orfèvre qui fabriquait des temples d’Artémis en argent,
procurait
ainsi aux artisans un gain considérable. Il les réunit, ainsi que les ouvriers des métiers
similaires, et leur dit : “C’est à cette industrie, vous le savez, que nous devons
notre bien-être.
Or, vous le voyez et l’entendez dire, non seulement à Éphèse, mais dans presque
toute l’Asie,
ce Paul, a convaincu et entraîné à sa suite une foule considérable, en affirmant
que les dieux
faits de main d’homme ne sont pas des dieux. Non seulement cela risque de jeter le discrédit
sur notre profession, mais encore de perdre la réputation du sanctuaire de la grande déesse
Artémis, et finir par dépouiller de son prestige celle que révèrent toute l’Asie
et le monde
entier.” À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier : “Grande
est l’Artémis des
Éphésiens !” » (Ac 19, 24-28.)
Si dans le récit des Actes, l’épisode se termine de manière
plutôt pacifique, grâce à
un discours apaisant d’un certain « scribe » (γραμματεύς),
il est très probable que Paul
eût à souffrir d’un emprisonnement. On déduit cette incarcération d’une
analyse
nouvelle de ce qu’on appelle les « épîtres de la captivité ».
Traditionnellement, on nommait « épîtres de la captivité »
l’Épître aux Philippiens,
l’Épître aux Colossiens, l’Épître aux Éphésiens, l’Épître à Philémon en les estimant
écrites à Rome. Les lettres mentionnent en effet un emprisonnement et transmettent un
« salut » à donner à la « maison de César » (Ph
4, 22), qui ne pouvait s’appliquer,
pensait-on, qu’au palais de l’empereur. Or, même si la plupart des exégètes
s’accordent
à nier l’authenticité de l’Épître aux Colossiens et de l’Épître
aux Éphésiens, les deux
épîtres qui « demeurent » fournissent suffisamment d’informations
pour dater cet
emprisonnement d’Éphèse. « La maison de César », en effet, est
certes le nom
spécifique du prétoire romain, siège de la garde prétorienne – les gardes du
corps de
l’Empereur – mais on sait que d’autres villes importantes de l’Empire avaient elles
aussi
des casernes prétoriennes. La domesticité impériale, par ailleurs, pouvait se rencontrer
partout où l’Empereur et la famille impériale avaient des propriétés. En outre,
dans le
billet à Philémon (Philémon 22), Paul espère revoir Philémon, après une
libération
prochaine. Or Philémon habite à Philippes : l’espérance est raisonnable quand
on sait
qu’Éphèse est assez peu éloignée de Philippes, mais irréaliste quand on
s’avise de ce
que Rome et Philippes sont à trois mois de bateau l’une de l’autre !
Le plus vraisemblable est donc de postuler un emprisonnement de Paul à Éphèse.
Emprisonnement peu strict, sans doute, puisqu’il a le loisir de correspondre et de se
tenir au courant de la situation de ses Églises.
Or l’une des choses urgentes qu’il doit régler, c’est la
crise de Philippes.
Philippes est la première ville véritablement européenne que Paul
put évangéliser ;
c’est également une communauté composée essentiellement de païens. La cité
avait
été fondée par le père d’Alexandre le Grand, Philippe. Elle connut son heure
de gloire
historique en 42 av. J.-C., lorsqu’Antoine et Octave y battirent les meurtriers de César,
Brutus et Cassius. Octave une fois empereur sous le nom d’Auguste, elle devint alors
colonie romaine et reçut le privilège insigne du jus italicum qui l’assimilait à
une ville
d’Italie. La cité, quoique située en Macédoine, était ainsi transportée
par une fiction
juridique à quelques kilomètres de Rome. Ses habitants ne payaient pas d’impôts
provinciaux ou de taxes personnelles, et ne dépendaient pas du gouverneur de
Macédoine mais de l’administration de Rome. On y parlait latin en pleine terre grecque,
même si tous y connaissaient la langue d’Homère.
Si l’on en croit les Actes (Ac 16, 12–17, 11), l’évangélisation
de Philippes fut des plus
mouvementées. Paul, après avoir fait la conversion de femmes assemblées dans un
lieu de prière juif à l’extérieur de la ville (sans doute une halte pour voyageurs),
guérit
une pythonisse, c’est-à-dire une sorte de devineresse populaire. Commence alors un
charmant roman selon le goût antique : les maîtres, furieux de se voir ainsi dérober
la
poule aux œufs d’or, dénoncent Paul aux autorités, qui le torturent et le laissent en
prison. Un ange, heureusement, vient le délivrer. L’histoire n’est sans doute pas sans
un
fond de réalité : il est probable que Philippes faisait partie de ces endroits où,
selon
l’apôtre (2Co 11, 23-25), il fut battu de verges. Malgré ces difficultés, Paul conserva
toute sa vie une tendresse toute particulière pour la ville de Philippes, qui, preuve
d’affection, ne cesse de lui envoyer des subsides.
Or visiblement, autour des années 54-55, la situation de l’Église
philippienne est en
train de se dégrader. Paul dut, ici encore, lui adresser une correspondance fournie. |
|
La lettre au Philippiens, quoiqu’elle semble d’une seule venue, présente
des
différences de ton flagrantes car Paul entend poursuivre plusieurs buts à la fois. Il
commence par donner des nouvelles de sa situation en prison (Ph 1, 1–3, 1a & 4, 2-9),
puis se lance dans une diatribe violente (Ph 3, 1b - 4, 1) et enfin remercie les Philippiens
de l’avoir assisté dans sa captivité (Ph 4, 10-20). |
|
Cette lettre « de prison » tire son nom des renseignements
qu’elle fournit sur les
conditions de détention de Paul. La situation de la communauté de Philippes demeure
dans l’ombre, ce qui laisse à penser que la crise est encore à venir. C’est un cas
unique
où Paul n’a pas à réprimander, à enseigner, à blâmer. Ces Philippiens
occupent une
situation unique dans le groupe des Églises pauliniennes – et donc dans sa
correspondance –, puisqu’ils ont participé depuis le premier jour à son travail,
financièrement bien sûr, mais également comme soutien moral et amical. Aussi avoue-t-
il son affection pour eux – « Dieu m’est témoin que je vous aime tous tendrement
dans
le cœur du Christ Jésus » (Ph 1, 8) – et les considère-t-il comme ses collaborateurs :
« Je me rappelle la part active que vous avez prise à l’Évangile depuis le
premier jour
jusqu’à aujourd’hui. » (Ph 1, 5)
Comme un ami donne des nouvelles à ses amis, Paul dit donc ses craintes
et ses
espoirs. Sa préoccupation principale : la crainte d’être exécuté. Heureusement,
la
procédure semble tourner à son avantage au prétoire (πραιτορός),
c’est-à-dire au
tribunal de la garde prétorienne ; elle est même une occasion de faire de la publicité
autour de l’Évangile.
« Je
tiens à vous le faire savoir, frères, ce qui m’est arrivé a plutôt contribué
au progrès de
l’Évangile : dans tout le Prétoire et partout ailleurs, mes chaînes sont devenus
une réclame
pour le Christ, et la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par ces chaînes,
redoublent d’assurance pour proclamer sans crainte la parole de Dieu. » (Ph 1, 13-14.)
Paul confesse son état d’esprit : mourir serait pour lui un gain,
car quitter cette vie
serait un moyen de retrouver son Seigneur Jésus. Mais l’intérêt seul de la communauté
prime pour un fondateur tel que lui. Aussi est-il tiraillé entre l’espérance et la
responsabilité. Ce débat intérieur se trouve extériorisé dans un fascinant
exercice de
vérité où se révèle une pensée en acte :
« Pour
moi la vie c’est le Christ et mourir est un gain. Cependant, si vivre dans cette chair
est utile à mon œuvre, je ne sais pas quoi choisir… Je me sens tiré des deux côtés :
je
voudrais bien m’en aller pour être avec le Christ, ce qui serait, et de beaucoup, bien
préférable ; mais d’un autre côté, demeurer dans la chair est encore plus
nécessaire à votre
bien. C’est avec cette conviction que je sais que je vais rester et demeurer auprès de vous
tous pour votre avancement et la joie de votre foi, afin que mon retour et ma présence parmi
vous soient pour vous un nouveau motif d’être fier dans le Christ Jésus. Seulement, menez
une vie digne de l’Évangile du Christ, afin que je constate – si je viens chez vous –
ou que
j’entende dire – si je demeure absent – que vous tenez bon dans un même esprit,
luttant de
concert et d’un même cœur pour la foi de l’Évangile. » (Ph 1, 21-27.)
Le besoin des Philippiens requiert qu’il choisisse la vie et continue de
se battre pour
eux. Ici, en effet, « la chair » désigne « ce monde ».
Aussi peut-il être certain d’être
libéré : puisqu’il est le seul à pouvoir s’occuper de l’Église
de Dieu, Dieu fera en sorte de
le sauver ; voilà un raisonnement de bon serviteur confiant dans le pouvoir de son
maître.
La seule critique que peut faire Paul, c’est la présence de divisions
au sein même de
la communauté (Ph 2, 1-2) et aussi, sans doute, une certaine prétention, une certaine
tendance à trouver orgueil d’être chrétien. Paul, rappelant sa théologie de
la croix, cite
un hymne traitant du Christ dans son abaissement :
« Lui,
qui était de condition divine, il ne crut pas devoir garder jalousement son égalité avec
Dieu : il s’anéantit lui-même au contraire, prenant la condition d’esclave,
et se faisant
semblable aux hommes. Et quand il eut ainsi visiblement tous les dehors de l’homme, il
s’abaissa lui-même, se faisant obéissant jusqu’à la mort, et à la mort
sur une croix. C’est
pourquoi Dieu l’exalta souverainement et lui donna le Nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et dans les enfers et
que toute
langue proclame, à la gloire de Dieu le Père, que Jésus Christ est Seigneur. »
(Ph 2, 6-11)
Le texte est extrêmement célèbre et a connu de nombreux commentaires.
Pour aller
à l’essentiel, trois lignes de réflexion extrêmement complexes s’entremêlent,
qui furent
d’une fécondité extrême pour la théologie. Pour la première fois, tout
d’abord, Paul
thématise sous forme d’hymne une pensée de la kénose, de l’abaissement
du Christ
qui met en réserve sa puissance divine pour se faire homme parmi les hommes.
Ensuite, il évoque le thème de l’obéissance du Christ au Père : cette
obéissance est-elle
une condition de l’exaltation ou une conséquence ? en d’autres termes, quels sont
les
rapports entre le Père et le Fils et quel rôle joue l’obéissance du Fils au Père
dans la
résurrection ? Enfin, on constate que cet abaissement permet, par une sorte de
passage complexe, l’exaltation : de la faiblesse naît la force, de l’abaissement
la
domination. Le Christ récapitule en lui toutes les souffrances du monde.
L’hymne, en outre, prend tout son relief quand on la rapporte à une Église un peu trop
fière d’elle-même, et fière d’une fierté de bon élève :
dans l’humilité se déploie la victoire
et non dans le contentement de soi puisque même le Christ « ne crut pas devoir garder
jalousement son égalité avec Dieu ». |
|
Si le travers de l’Église de Philippes n’avait été que
la prétention, le prisonnier
d’Éphèse pourrait calmer ses inquiétudes ! Mais, voici que, malgré les
excellentes
relations de l’apôtre avec sa communauté, celle-ci capitule devant la contre-offensive
judaïsante qui remonte patiemment les traces de la mission paulinienne. Le ton
qu’emploie Paul est ici très polémique et on y retrouve les mêmes exhortations à
la
vigilance que dans l’Épître aux Galates.
« Prenez
garde aux chiens ! Prenez garde aux mauvais ouvriers ! Prenez garde aux
“circoncis” ! Car c’est nous qui sommes les circoncis, nous qui servons Dieu selon
son esprit
et tirons notre gloire du Christ Jésus, sans placer notre confiance dans la chair. »
(Ph 3, 2-3.)
L’ambiance est ici à l’insulte et à l’ironie mordante.
Traiter quelqu’un de « chien » était
des plus injurieux tant cet animal était dévalué dans la civilisation antique ;
Paul n’hésite
pourtant pas à le faire. Moquer la circoncision constituait une sorte de sacrilège, Paul ne
recule pas devant un emploi ironique et devant un détournement de la nature de la
circoncision. La vraie circoncision est celle de la foi (servir Dieu « selon son esprit »)
et
non celle de la chair, imposée par la Loi.
Les Philippiens cédèrent-ils à l’offensive ? Peu importe.
Paul fit un voyage en
Macédoine au sortir de sa captivité, qui lui donna l’occasion de remettre les choses
en
place. En outre, contrairement à l’Épître aux Galates, l’Épître aux
Philippiens reste au
stade des mises en garde. On y sent comme une complicité qui se passe des longues
explications et de la pédagogie besogneuse de l’Épître aux Galates : un jeu
de mot et
rien de plus. Une lettre du fondateur suffisait probablement à faire autorité. |
|
Ce passage nous renseigne sur le rapport que Paul entretient avec ses Églises.
L’apôtre semble, en effet, gêné d’avoir reçu de l’argent : s’il
remercie ses
correspondants, il ne se prive pas de leur dire qu’il n’avait pas besoin de leurs subsides :
« Ce
n’est pas le besoin qui m’inspire ces paroles ; car j’ai appris à me contenter
de mon
sort. Je sais vivre dans l’abondance comme dans la pauvreté. En tout temps et de toutes les
manières, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l’abondance
comme au dénuement.
Je puis tout en celui qui me rend fort. Toutefois vous avez eu raison de vous préoccuper de
ma détresse. » (Ph 4, 11-14.)
Paul travaille de ses mains et met un point d’honneur à ne pas être à la charge de
ses communautés. Il accepte donc cet argent, davantage comme un témoignage
d’affection et de piété que comme un dû.
« Ce
n’est pas que je recherche les dons ; ce que je recherche, c’est le bénéfice
qui
s’augmente à votre compte. Pour le moment j’ai tout ce qu’il faut, et même
davantage, je suis
comblé, ayant accepté d’Épaphrodite votre offrande, parfum de bonne odeur, sacrifice
qui plaît
à Dieu et qu’il trouve agréable. » (Ph 4, 17-18.) |
|
Dernier épisode de la captivité d’Éphèse : l’affaire
Onésime. Cet esclave en fuite de
chez son maître Philémon, était venu trouver l’apôtre dans sa prison, pour
lui demander
aide et protection. Ce dernier, qui visiblement l’aime beaucoup, finit cependant par le
renvoyer à son maître accompagné d’un petit mot. Sa lettre est extrêmement
belle dans
sa sincérité.
Elle commence cependant comme une lettre publique : en faisant sa demande
devant la communauté, il espère bien que cette pression sociale contraindra Philémon.
Il développe ensuite deux arguments très subtils. Le premier est une inversion des
rapports sociaux : Philémon, quoique maître d’Onésime dans ce monde, lui est
bien
inférieur dans la connaissance du Christ. Ce dernier devient ainsi un frère très cher
pour
Philémon et sans doute plus : une sorte de parrain dans la foi :
« Peut-être
n’a-t-il été séparé un instant de toi que pour t’être rendu pour
l’éternité, non plus
comme un esclave, mais bien mieux qu’un esclave, comme un frère bien aimé : il l’est
tellement pour moi, combien va-t-il l’être pour toi ! selon la chair et selon le Seigneur ! »
(Philémon 15-16.)
Onésime, parce qu’il est chrétien, devient un frère pour
Philémon. Frère dans ce
monde, « selon la chair » mais aussi dans la suite de l’histoire « pour
l’éternité et selon
le Seigneur ».
Le second argument est purement privé : Paul fait appel à la mansuétude
de
Philémon comme une faveur personnelle.
« Si
donc tu me considère comme ton ami, accueille-le comme si c’était moi. Et s’il t’a
fait
du tort ou te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, je te l’écris de ma
propre main : c’est moi qui paierai… et je ne veux pas parler de ce que tu me dois :
toi-
même ! » (Philémon 17-19.)
La dette de Philémon est en effet immense : il doit à Paul…
lui-même, c’est-à-dire le
fait d’être une nouvelle créature, une homme renouvelé par le christianisme.
Onésime fut-il ou non châtié par son maître ? L’histoire
ne se poursuit pas et les
épîtres cessent de mentionner son nom. Une tradition fondée sur une épître
d’Ignace,
évêque d’Antioche conduit au martyre à Rome, veut qu’il devint par la suite évêque
d’Éphèse. |
|
|
|
|
|
 1. AVANT SA VOCATION
1. AVANT SA VOCATION